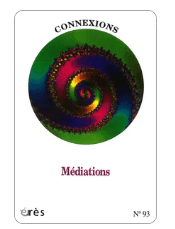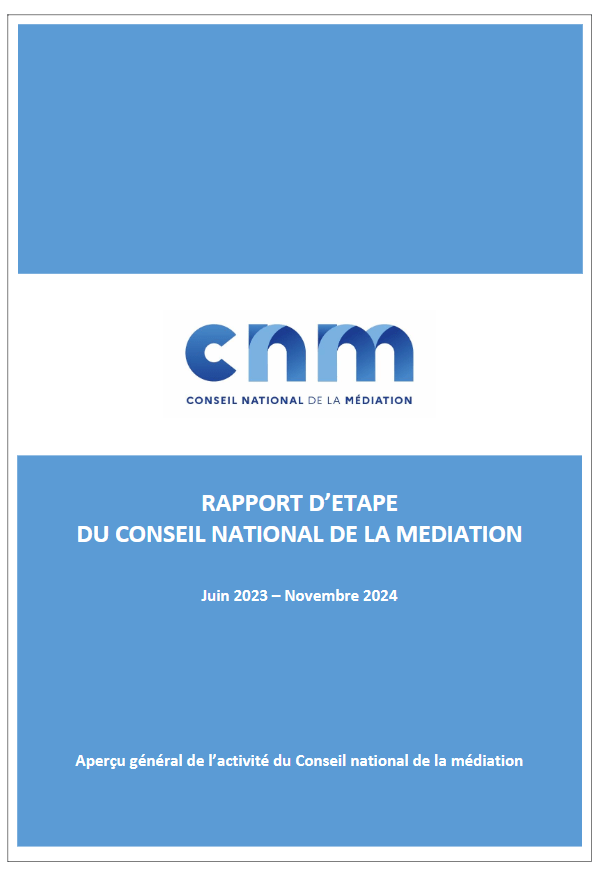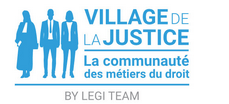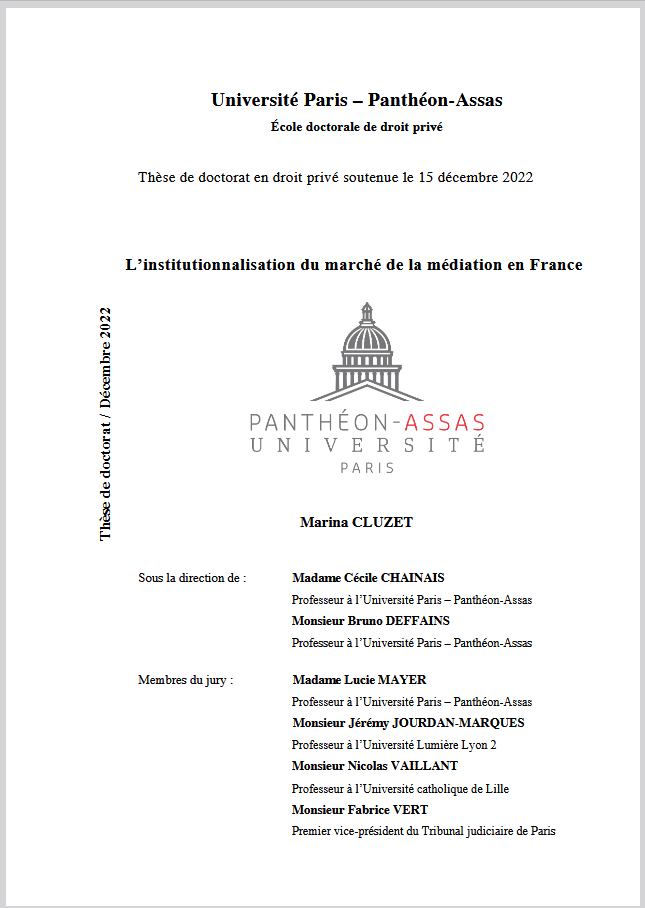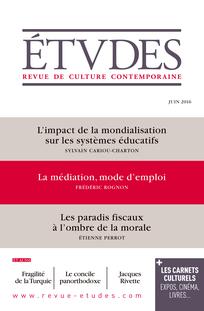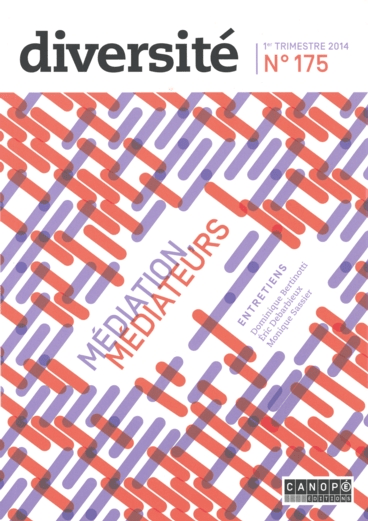
« Le Médiateur de la République, les médiateurs du livre, les médiateurs chimiques, l’agent de médiation, l’enseignant-médiateur, le parent-médiateur, la médiation des apprentissages… Comment s’y retrouver ? Parle-t-on de la même chose ou n’aurait-on pas dû parfois choisir un autre mot pour ces situations visiblement si différentes ?
Médiation dans les conflits sociaux, médiation familiale, médiation de voisi nage, médiation à l’école… Retrouvant souvent aux détours de tous nos chemins, les termes médiation et médiateur, nous
avons appris à les reconnaître comme liés aux règlements des nombreux conflits qui émaillent notre vie sociale et individuelle puis, petit à petit, à leur prévention. Spontanément, nous les décryptons en fonction de leur contexte. Mais que veulent bien dire exactement ces mots ? « (Extrait)
Article à consulter sur https://www.persee.fr/doc/diver_1769-8502_2014_num_175_1_3868?q=M%C3%A9diation%20