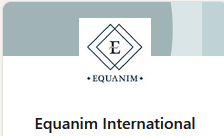
« La loi n°2024-346 du 15 avril 2024 a créé une base légale à la théorie d’origine prétorienne des troubles anormaux de voisinage.
Désormais, le nouvel article 1253 du Code civil dispose que tout propriétaire, locataire, ou occupant qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage est responsable de plein droit des dommages qui en résultent.
▶ En vertu de l’article 750-1 du Code de procédure civile, les demandes en justice qui tendent au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage doivent être précédées, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative.
L’entrée dans le Code civil de la théorie des troubles anormaux de voisinage vient donc, indirectement, préciser un peu plus le champ d’application des obligations préalables de conciliation. (Extrait de linkedin.com du 17/04/2024)
En savoir plus sur https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7186271433801572353/








